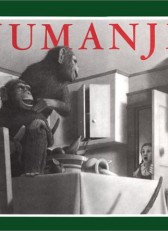L’histoire d’un homme complètement déphasé qui semble toujours prendre la pire décision possible, qu’elle soit d’ordre personnelle ou professionnelle !
Premier ouvrage de John Dunthorne à paraitre en France, Les désaccordés est paru chez Gallimard en début d’année 2019. Il nous conte l’histoire d’un couple qui a passé la trentaine et qui peine à trouver une place dans la société…
Journaliste freelance, une situation peu idéale…
Ray Morris est journaliste, il rédige de nombreux avis sur des produits ou autres pour gagner sa vie. Il fait son travail, ni plus ni moins. Il n’est pas médiocre, ni exceptionnel. En fait, Ray est un peu fade, à l’image de sa vie. Mais ses enchaînements incroyables de mauvaises décisions vont le rendre incroyable… mais pas dans le bon sens du terme… Sa femme Garthene quant à elle est très enceinte et tente de concilier travail et vie perso qui tourne au cauchemar…
… encore moins quand on va fonder une famille
De déconvenues minimes en déboires terribles, nous suivons le parcours du combattant pour ce couple qui tente de trouver sa place dans une société Londonienne qui laisse peu de place aux gens modestes. En effet, à cause du travail non fixe de Ray, il est difficile pour lui et sa femme de trouver une maison. Les banques sont frileuses quand elles voient le statut de Ray, et Garthene accouchant bientôt, le temps presse…
Mais justement, le temps pressant, tout cela met la pression à Ray, qui va à chaque fois prendre le pire chemin possible pour lui et sa famille. Les désaccordés est censé être un livre drôle, sinon décalé, mais à aucun moment je n’ai réussit à rire franchement de ce que je lisais.
Je n’ai aucunement réussit à m’attacher de près ou de loin à Ray (à peine à Garthene) tant tout ce qu’il fait est illogique/égoïste/stupide…
J’ai ainsi été assez consternée tout au long du roman, m’attendant à ce que l’histoire commence enfin. Mais j’ai bien dû me rendre à l’évidence quand je suis arrivée à la dernière page… La vie de Ray n’a ni queue ni tête, il n’est pas attachant, surtout instable et très désagréable.
En somme, du début à la fin, je n’ai pas réussit à me plonger dans la vie de ces fameux « désaccordés ». Pas d’empathie pour les personnages, aucun trait d’humour n’ayant réussit à me tirer un sourire… C’est une déception cuisante pour moi qui espérait une analyse fine et décalée de la société anglaise et plus particulièrement Londonienne…